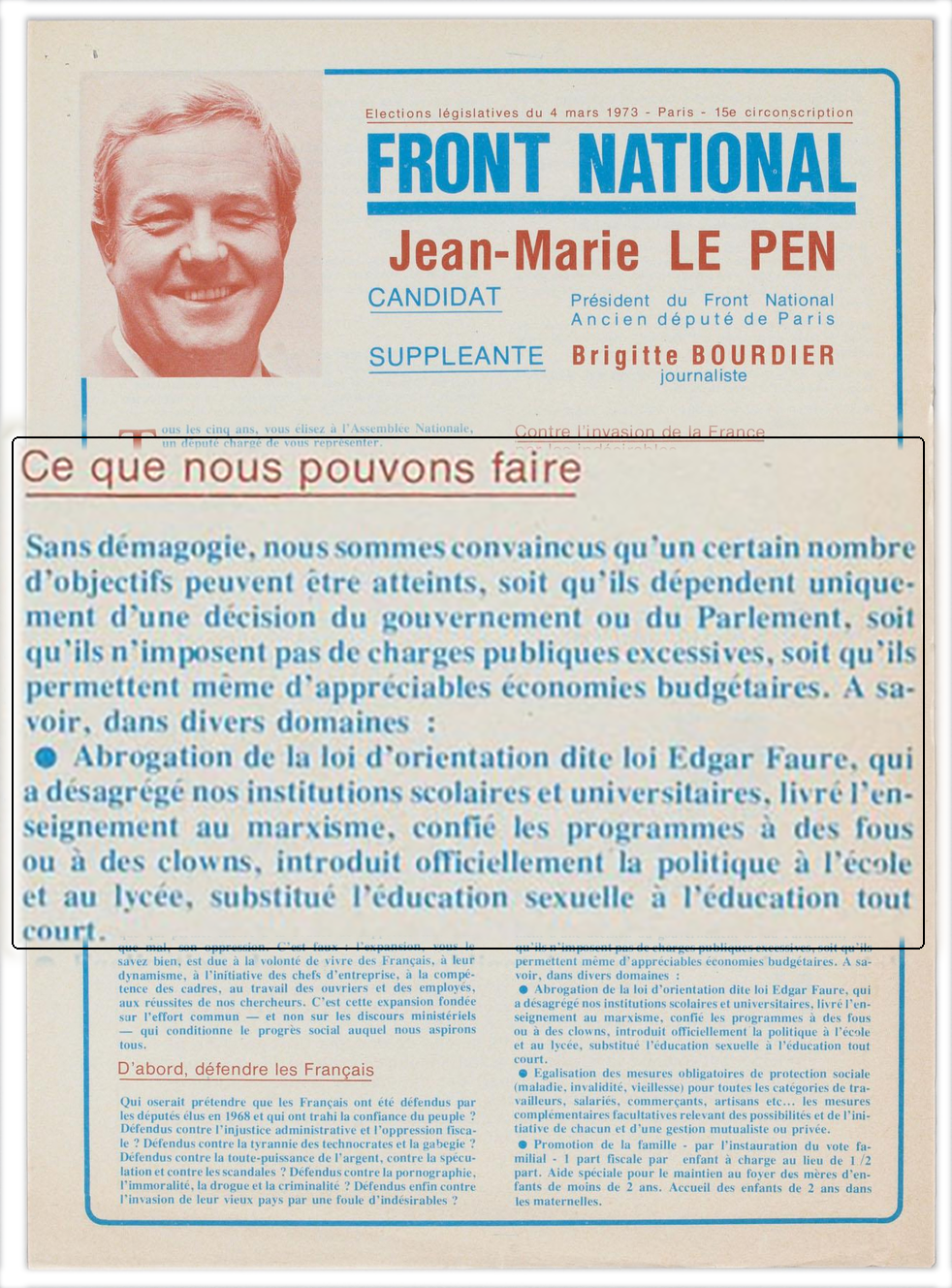Peut-on destituer le Hcéres ? Et quelques autres questions
Rendez-vous…
- À Paris, rassemblement à 14h, place Jussieu
- À Rennes, rendez-vous à 12h, République
- À Toulouse, rendez vous à 14h, métro Jean Jaurès
- À Strasbourg, rassemblement à 14h, Campus de l’Esplanade, bâtiment de la Présidence
Merci de prendre connaissance des conseils pratiques en fin de texte pour la manifestation.
Peut-on destituer le Hcéres ? Et quelques autres questions
La loi de programmation de la recherche a été adoptée le 20 novembre par le Sénat, dans sa version issue de la commission mixte paritaire. La Constitution permet au Président de demander une nouvelle délibération de loi (article 10, alinéa 2 de la Constitution). Les collègues qui le souhaitent peuvent s’associer à une lettre l’y enjoingant.
Le travail juridique pour déterminer l’opportunité d’une saisine du Conseil Constitutionnel est en cours. Nous pouvons mettre en contact avec le groupe de travail, les collègues constitutionnalistes qui souhaitent y apporter leur contribution.
Aux côtés d’autres collectifs, RogueESR appelle à la manifestation du mardi 24 novembre, journée de grève et de mobilisation nationale dans le prolongement de l’opération « Écrans noirs ». Pour la suite, il importe de prendre le temps de construire collectivement une stratégie de transformation globale des institutions d’enseignement supérieur et de recherche (ESR), et de concevoir des tactiques à déployer à court terme. Cela suppose de réfléchir à des leviers dont les effets garantissent une prise politique, en évitant ceux qui pourraient être pernicieux, saperaient nos collectifs de travail, voire scinderaient les alliances nouées dans notre communauté ces derniers mois ou accéléreraient la différenciation entre les établissements.
Désormais, le cœur de la bataille est l’autonomie effective de la recherche, garantie par des statuts pérennes, par des moyens récurrents, et par la réaffirmation des libertés académiques. Or, même si nous ne disposons pas des leviers institutionnels nécessaires pour faire advenir ici et maintenant l’Université et la recherche que nous voulons, nous pouvons collectivement réfléchir aux premiers jalons pour y parvenir. Si l’objectif est d’initier un mouvement de réappropriation de nos métiers, nous devons penser le système que nous voulons instituer en commençant par nous poser quelques questions précises.
Peut-on destituer le Hcéres en décidant partout d’ignorer son existence, purement et simplement ? Peut-on mettre en œuvre des visites des laboratoires par les pairs en poursuivant des objectifs conformes aux principes de la science : intégrité, exigence, disputatio, originalité des travaux, bienveillance ? Peut-on imposer collectivement que les évaluations se fassent sur la base de la lecture des travaux ? Peut-on réduire le recours au travail précaire en valorisant le principe de division minimale du travail savant ? Peut-on remplacer l’évaluation managériale par une gratification par les pairs, fondée sur la disputatio ? Comment évaluer en retour les nouveaux managers de l’Université et de la recherche, avec une notation chiffrée, objectivée, fondée sur des critères multiples en évolution permanente, afin de leur permettre d’améliorer leurs propres performances dans l’accompagnement de la science, selon des critères collectivement décidés par la communauté académique ? Comment sortir du modèle unique du principal investigator (PI) que chérissent les appels à projet, et encourager les chercheurs à mener eux-mêmes leur recherche au quotidien ? Comment refonder des structures capables d’amener universitaires et chercheurs à retrouver le sens de leur métier ? Les chances d’initier une réinstitution de l’Université et de la recherche dépendent de la réponse que nous apporterons collectivement à ces questions dans les semaines à venir.
Malgré le marasme ambiant, des signes encourageants surgissent. La pétition demandant la suspension de l’examen de la loi a dépassé les 30 000 signataires.
Pour la première fois depuis des mois, nous avons obtenu une couverture médiatique importante, depuis la une du Monde[1] jusqu’à Ouest France. La mobilisation des collègues de droit, l’unanimité des protestations venant de toutes les disciplines et de tous les bords témoignent de la constitution graduelle d’un « Nous » réunifiant les universitaires et les chercheurs actifs, statutaires et précaires, en face d’un « Eux » constitué par les nouveaux managers de l’Université et de la Recherche, qui ont porté le projet de loi jusqu’à produire des amendements sénatoriaux délétères. Ainsi, les textes écrits par les collègues de Qualité de la Science Française[2] marquent un tournant dans la désignation explicite de celles et ceux qu’il nous faut affronter. Cette partition entre Nous et « Eux » est allée jusqu’à diviser les Républicains, dont les députés ont voté contre la LPR, après les discours argumentés, aux accents gaulliens, de M. Patrick Hetzel. Ce faisant, les députés LR ont déjugé les sénateurs de leur propre parti. Ceux-ci, menés par M. Bruno Rétailleau, un transfuge de la droite religieuse radicalisée, incarnée par son mentor M. Philippe de Villiers, avaient en effet négocié avec les présidences de l’UDICE[3] et servi leurs intérêts par le truchement des amendements portés notamment par Mme Laure Darcos. Soulignons enfin que notre collègue Cédric Villani, qui a servi de caution à la LPR pendant un an, a in fine voté contre le texte. Que d’énergie dissipée et, surtout, que de gâchis pour accoucher de ce texte de loi mortifère pour l’ESR.
Conseils pour la manifestation du 24 novembre
Précautions : Imprimez et remplissez l’attestation dérogatoire.
Les organisateurs ont obtenu un récépissé de la préfecture. En cas d’insistance lors d’un contrôle, montrez aussi n’importe quel appel à la manifestation de la part d’un syndicat ou d’un collectif. Merci à ceux qui possèdent des masques FFP2 non-médicaux d’en apporter en réserve, pour assurer une protection optimale. Évitez les masques de coton simple et en particulier ceux au travers desquels on voit le jour. Privilégiez des masques jointifs aux arêtes du nez, en intissé (e.g. masque chirurgical avec pince-nez). Il nous faudra respecter des distances métriques entre nous et privilégier les endroits bien ventilés permettant la dispersion rapide des émissions en aérosol.
- Les avancées en trompe-l’œil de la loi de programmation de la recherche, censée empêcher le décrochage de la France
- « La recherche n’échappe pas à la dérive liberticide du gouvernement »
- La loi sur la recherche scientifique, une occasion manquée
[2] Les articles des collègues de Qualité de la Science Française :
- Recrutements universitaires : la dérégulation en marche
- Recrutement universitaire : « La prime au localisme et au clientélisme »
[3] L’UDICE est une émanation de la CURIF, association proche de LREM qui a proposé le nom de Mme Vidal pour occuper les fonctions ministérielles. L’UDICE rassemble les présidences d’Aix-Marseille Université, de Sorbonne Université, de l’Université Claude Bernard Lyon 1, de l’Université Côte d’Azur, de l’Université de Bordeaux, de l’Université de Paris, de l’Université de Strasbourg, de l’Université Grenoble Alpes, de l’Université Paris Saclay, de l’Université Paris Sciences et Lettres. L’UDICE a coécrit une large part de la LPR.